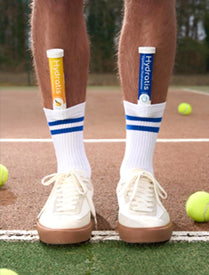Vous imaginez sans doute la déshydratation comme un simple manque d'eau dans le corps. Pourtant, il s'agit d'un phénomène bien plus complexe. Il résulte d'un déséquilibre entre les différents compartiments hydriques de l'organisme et peut prendre plusieurs formes. Parmi elles, on distingue la déshydratation intracellulaire (DIC), qui touche directement les cellules et perturbe leur fonctionnement. Ses effets sur la santé, notamment sur les plans neurologique et métabolique, sont loin d'être anodins.
Qu'est-ce que la déshydratation intracellulaire ?
Pour mieux comprendre, imaginez que les liquides de votre corps circulent entre deux grands espaces : l'intérieur des cellules, appelé secteur intracellulaire, et le milieu qui les entoure, dit extracellulaire, qui comprend le plasma sanguin et les tissus interstitiels.
En temps normal, ces deux compartiments échangent de l'eau et des électrolytes selon le principe d'osmose : les fluides se déplacent du milieu le moins concentré en solutés vers celui qui l'est davantage, pour ainsi maintenir l'équilibre.
Lorsque la concentration en particules dissoutes augmente dans le sang — par exemple en cas d'hypernatrémie (taux de sodium trop élevé) — l'eau quitte les cellules pour rejoindre le milieu extérieur. C'est ce qui provoque la déshydratation intracellulaire ou hyperosmotique. Elle correspond donc à une diminution significative du volume hydrique à l'intérieur de vos cellules.
Déshydratation intra vs extracellulaire : quelle différence ?
À l'inverse, la déshydratation qui touche le liquide autour des cellules se manifeste surtout par une baisse de la pression sanguine, une hypotension, et parfois un choc hypovolémique. Elle survient lors de vomissements importants, de diarrhées sévères ou d'hémorragies.
Dans la pratique, il n'est pas rare que les deux formes coexistent quand les deux milieux sont simultanément affectés. On parle alors de déshydratation globale.
Quelles sont les causes de la déshydratation intracellulaire ?
Après avoir défini ce phénomène, examinons maintenant les différents facteurs à l'origine de ce déséquilibre.
Apports insuffisants
Lorsque vos apports sont trop faibles, le corps cherche à compenser en puisant dans les cellules. Cette situation touche particulièrement les personnes âgées, les nourrissons et les patients dépendants.
Diabète insipide et perturbations hormonales
Le diabète insipide est caractérisé par un déficit ou une résistance à l'hormone antidiurétique (ADH), aussi appelée vasopressine. À cause de ce dérèglement, vous urinez beaucoup, même si vous ne buvez pas suffisamment. Cette élimination massive d'urine provoque une concentration de sels dans le plasma, obligeant l'eau à quitter les cellules pour corriger le déséquilibre osmotique.
Fièvre, efforts intenses, exposition à la chaleur
Dans ces situations, le corps perd beaucoup de liquide par la transpiration et par évaporation cutanée. Sans compensation adéquate, le sang devient plus concentré en particules et crée les conditions d'une hypernatrémie secondaire.
Médicaments diurétiques ou laxatifs
Certains diurétiques ou laxatifs (souvent prescrits contre l'hypertension ou l'insuffisance cardiaque) augmentent la diurèse. Cela élève l'osmolalité sérique et provoque un mouvement des fluides de l'intérieur des cellules vers l'extérieur.
Quels sont les signes cliniques d'une déshydratation intracellulaire ?

Maintenant que vous avez compris de quoi il s'agit, voyons comment ce déséquilibre peut se manifester et quels symptômes doivent vous alerter.
Troubles neurologiques : confusion, somnolence, agitation
Votre cerveau est l'un des premiers organes touchés. C'est pourquoi les premières manifestations sont souvent d'ordre neurologique. Vous pouvez présenter :
- une confusion mentale ;
- une somnolence inhabituelle ;
- une irritabilité ou une agitation soudaine.
Dans sa forme aiguë ou sévère, des convulsions ou même un coma peuvent survenir, en raison de la souffrance cérébrale.
Fatigue, soif intense, sécheresse des muqueuses
L'indicateur le plus évident est l'envie intense de boire, signe que votre organisme tente de corriger le tir. Cette sensation s'accompagne généralement d'une sécheresse des muqueuses (bouche sèche, langue pâteuse…) et d'une fatigue générale.
Votre peau pourrait également perdre son élasticité normale. Le pli cutané après pincement met plus de temps à disparaître qu'en temps normal.
Perte de poids rapide, tension basse, troubles urinaires
Vous pouvez également constater :
- un amaigrissement rapide, surtout si le déséquilibre touche à la fois les deux compartiments ;
- des vertiges au lever traduisant une chute de la tension artérielle en position debout ;
- des urines plus foncées et peu abondantes, car vos reins essaient de retenir le maximum de liquide (sauf dans certains cas particuliers comme le diabète insipide).
Comment diagnostiquer une déshydratation hyperosmotique ?
Face à ces signaux, un diagnostic précis est essentiel pour identifier la cause du déséquilibre.
Diagnostic clinique : observation des symptômes
Votre médecin commence par un examen clinique attentif. Il s'intéresse à vos habitudes d'hydratation, recherche une éventuelle fièvre, examine vos traitements en cours et cherche à détecter d'éventuelles pertes hydriques (transpiration importante, diarrhée, rejets gastriques).
Il recherche ensuite les symptômes évoqués précédemment : fatigue, confusion, sécheresse buccale ou baisse de tension...
Cette première évaluation permet souvent de suspecter le problème et d'en estimer la gravité (légère, modérée ou sévère).
Examens complémentaires : ionogramme sanguin, osmolarité, urée
Pour confirmer le diagnostic, un certain nombre d'analyses biologiques peuvent être prescrites :
- Ionogramme sanguin : mesure les principaux électrolytes du sang (sodium, potassium, chlore, bicarbonates) pour identifier le type de déséquilibre.
- Osmolarité plasmatique : renseigne sur la concentration en particules dissoutes dans le sang (sels, glucose, urée). Une osmolarité élevée indique généralement une perte de fluides à l'intérieur des cellules.
- Urée et créatinine : leur hausse dans le sang permet de contrôler la fonction rénale.
Identifier les déséquilibres intra vs extra
L'ensemble de ces examens permet de déterminer si le déséquilibre concerne principalement l'intérieur des cellules ou l'espace extérieur.
Parfois, les résultats peuvent révéler une hyponatrémie par hyperhydratation intracellulaire, situation inverse qui correspond plutôt à un excès d'eau à l'intérieur de vos cellules.
Dans certains cas, une hospitalisation urgente est nécessaire, souvent en service de néphrologie ou de réanimation.
Prise en charge et prévention
Réhydratation : solutions orales ou perfusions adaptées
Dans les formes légères à modérées, la réhydratation orale est privilégiée. Une perfusion intraveineuse sera nécessaire pour les cas plus graves ou si vous êtes dans l'incapacité de boire. Le type de solutés (hypotoniques ou isotoniques) et la vitesse d'administration seront ajustés en fonction de vos résultats d'analyses et de votre état général.
Une correction trop rapide peut être dangereuse. En effet, un afflux brutal de liquide dans vos cellules risquerait de provoquer un œdème cérébral. C'est pourquoi les protocoles médicaux préconisent une baisse progressive de la natrémie.
En parallèle, un traitement adapté de la cause sous-jacente (diabète insipide, fièvre, diarrhée, etc.) doit être également proposé.
Cette approche globale permet de corriger non seulement les conséquences, mais aussi l'origine du déséquilibre, réduisant ainsi le risque de récidive.
Prévention

La prévention reste votre meilleure protection. Elle repose sur l'adaptation de vos apports hydriques à vos besoins réels, qui varient selon votre âge, votre masse corporelle, votre niveau d'activité physique et les conditions climatiques.
- Adultes : consommez par petites gorgées jusqu'à 1,6 à 2 L par jour.
- Sportifs : buvez avant, pendant et après l'effort, en suivant un plan d'hydratation adapté à votre profil.
- Enfants et seniors : proposez-leur à boire régulièrement car ils ne l'expriment pas toujours spontanément.
- En cas de forte chaleur : augmentez votre apport et buvez davantage, même si vous n'en ressentez pas le besoin.
Évitez de compter les boissons sucrées, alcoolisées ou trop caféinées dans vos apports hydriques.
Surveillance en milieu médical
Si vous êtes hospitalisé, votre indice pondéral sera régulièrement contrôlé. Un amaigrissement rapide peut cacher un déséquilibre à corriger sans délai pour éviter toute décompensation.
Le personnel soignant suit également vos entrées et sorties hydriques, contrôle la couleur et la quantité des urines, et reste attentif à tout signal de fatigue ou de confusion.
Ce suivi rigoureux permet d'anticiper les déséquilibres avant qu'ils ne s'aggravent, en particulier chez le patient âgé ou atteint de maladies chroniques.
Questions fréquentes sur la déshydratation intracellulaire
Quels sont les signes de déshydratation intracellulaire ?
Soif intense, sécheresse buccale, fatigue, perturbations neurologiques (confusion, agitation) et coma dans les cas graves.
Quelles sont les causes de la déshydratation hyperosmotique ?
Apports insuffisants, maladies endocriniennes, chaleur, effort, médicaments diurétiques ou pertes massives (rejets gastriques, diarrhées).
Qu'est-ce qui peut provoquer une déshydratation cellulaire ?
L'osmose : si le sang devient trop concentré en sel ou en sucre, l'eau sort des cellules pour rétablir l'équilibre.
Comment reconnaître une hyperhydratation intracellulaire ?
Elle survient surtout lors d'une hyponatrémie sévère. Ses symptômes sont : les céphalées, nausées, vomissements, problèmes neurologiques, voire un œdème cérébral dans les cas extrêmes.
Conclusion
La déshydratation intracellulaire est un déséquilibre grave qui touche directement vos cellules. Elle peut découler d'un simple manque d'eau, mais aussi de maladies ou de traitements spécifiques. Pour vous protéger, soyez attentif aux signaux précoces. Le diagnostic médical, appuyé par des examens biologiques, permet d'agir vite et de choisir la bonne stratégie de réhydratation. En adoptant des gestes simples (boire régulièrement, adapter vos apports, surveiller les personnes fragiles), vous réduirez considérablement les risques et vous préserverez l'équilibre vital de votre organisme.
Bibliographie
Lopez, M. J., & Hall, C. A. (2023, March 13). Physiology, osmosis. In StatPearls (Online edition). StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557609/
Sonani, B., Naganathan, S., & Al-Dhahir, M. A. (2023, August 24). Hypernatremia. In StatPearls [Internet]. StatPearls Publishing. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK441960/
Verbalis J. G. (2010). Managing hyponatremia in patients with syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion. Endocrinologia y nutricion : organo de la Sociedad Espanola de Endocrinologia y Nutricion, 57 Suppl 2, 30–40. https://doi.org/10.1016/S1575-0922(10)70020-6
Gankam Kengne, F., & Decaux, G. (2017). Hyponatremia and the Brain. Kidney international reports, 3(1), 24–35. https://doi.org/10.1016/j.ekir.2017.08.015
Yun, G., Baek, S. H., & Kim, S. (2023). Evaluation and management of hypernatremia in adults: clinical perspectives. The Korean journal of internal medicine, 38(3), 290–302. https://doi.org/10.3904/kjim.2022.346