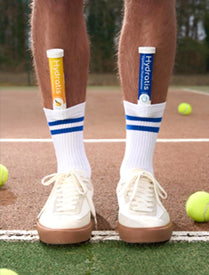Les dangers liés à une mauvaise hydratation ou une déshydratation non contrôlée ne sont pas toujours connus. On parle souvent du manque d’électrolytes ou du manque d’eau et de leurs conséquences, mais que se passe-t-il lorsque l’équilibre entre la quantité d’eau dans notre corps et les minéraux n’est pas bon ? Dans cet article, nous allons aborder le sujet de l’hypernatrémie, qui est la conséquence d’une concentration trop importante en sodium dans le corps lors d'une déshydratation ou un mauvais apport en électrolytes.
1. Comment calculer le déficit en eau dans l'hypernatrémie ?
Calculer son déficit en eau libre est un indicateur pour savoir quelle quantité d’eau libre nous devons consommer pour rétablir l’équilibre avec le sodium.

1.1 Formule du calcul du déficit en eau libre :
Le calcul est donné par la formule suivante :
Déficit en eau libre = (eau corporelle totale) x {(natrémie actuelle/natrémie cible) - 1}
L’eau corporelle totale dépend de l’âge, du sexe et du niveau de masse grasse d’une personne. Pour faire simple, cela représente 60% du poids d’un homme, 50% d’une femme et 50% pour une personne âgée. Prenons l'exemple d'un homme de 70 kg, son eau corporelle totale va représenter 70×0,6=42 L.
La natrémie actuelle est en fait la concentration mesurée en sodium dans le plasma sanguin (en mmol / litre).
La natrémie cible, est l’objectif à atteindre et il est fixé à 140 mmol / litre. Au-delà de ce niveau, l’hypernatrémie devient de plus en plus grave et nécessite des soins d’autant plus importants.
1.2 Exemple de calcul :
Pour un homme de 70 kg avec une natrémie actuelle de 155 mmol / litre :
L’eau corporelle totale est égale à 42 litres.
Le déficit en eau libre = 42 × 155140 - 1 = 42 × 0,107 = 4,5 litres.
Cet homme a donc un déficit d’eau libre de 4,5 litres.
2. Qu'est-ce que l'hypernatrémie ?
2.1 Relation entre l'hypernatrémie et le déficit en eau libre
Avant tout, l’hypernatrémie est le nom donné au phénomène qui se produit lorsque la concentration en sodium dans le sang est trop élevée. Le problème est que l’hypernatrémie (concentration en sodium dans le sang) augmente notre osmolarité plasmatique (nombre de particules actives : le sodium, le potassium, le sucre par exemple…) et cela provoque une déshydratation intracellulaire.
Lorsqu’on a cherché à calculer notre déficit en eau libre, c’est en fait la quantité d’eau qui est nécessaire pour que la concentration en sodium redevienne normale.
3. Les causes de l'hypernatrémie
L’hypernatrémie peut avoir plusieurs formes, celles-ci sont définies en fonction du volume extracellulaire qui en résulte. Il y a trois possibilités : soit il diminue, soit il reste constant, soit il augmente.
3.1 Hypernatrémie hypovolémique

L’hypernatrémie hypovolémique est causée par une perte d’eau libre plus importante que le sodium, ce qui augmente la concentration en sodium et diminue le volume extracellulaire. En effet, si nous avons un équilibre entre l’eau et le sodium mais que l’on perd plus d’eau que de sodium, alors sa concentration augmente, cela crée une hypernatrémie.
Les causes principales sont : des diarrhées, des vomissements, une transpiration importante ou encore le diabète.
3.2 Hypernatrémie euvolémique
En second lieu, nous avons l’hypernatrémie euvolémique. Plus simplement, celle-ci arrive lorsque l’on perd exclusivement de l’eau et non pas de sodium, cela va une nouvelle fois faire augmenter sa concentration, mais en conservant un volume extracellulaire stable. Elle peut être la conséquence d’une transpiration excessive, d’hyperventilation ou encore d’insuffisance rénale.
3.3 Hypernatrémie hypervolémique
Maintenant voyons un troisième cas, l’hypernatrémie hypervolémique. C’est le fait d’avoir une trop grande rétention de sodium par rapport à l’eau, qui va ensuite provoquer de l'hypernatrémie. Ce phénomène qui est dû à un apport trop important en sodium dans l'alimentation, va augmenter le volume extracellulaire.
4. Symptômes de l'hypernatrémie
Les symptômes de l’hypernatrémie sont liés à l’osmolarité trop importante dans le plasma sanguin et à la déshydratation intracellulaire. Ils sont assez nombreux et dépendent des différents types de déséquilibres que nous avons cités plus tôt :
|
De plus, des symptômes neurologiques peuvent également apparaître. Ainsi, en plus d’une soif marquée, vous pouvez ressentir de la fatigue, de l’irritabilité, des maux de tête, une faiblesse musculaire et une désorientation. Ces symptômes tendent à s’aggraver au fur et à mesure que l’hypernatrémie progresse.
5. Diagnostic de l'hypernatrémie
Pour diagnostiquer l’hypernatrémie, le mieux reste l’évaluation clinique, avec la mesure de la natrémie plasmatique afin de connaître votre concentration en sodium. Pour vous donner une idée :
Une concentration comprise entre 146 et 150 mmol /L correspond à une hypernatrémie légère,
Entre 151 et 159 mmol /L, elle devient modérée
Et si elle est supérieure à 160 mmol /L, le cas est sévère.
Si vous allez chez le médecin, il prendra votre tension, regardera l’état de vos muqueuses et s’il y a des signes d’œdème, pour ainsi vérifier les différents symptômes que nous avons vu. Il se peut qu’il y ait également une analyse urinaire pour contrôler la concentration de sodium dans votre corps.
6. Gestion de l'hypernatrémie
L'hypernatrémie, qui correspond à un excès de sodium dans le sang, est souvent due à une déshydratation importante. Pour rétablir l’équilibre, il est essentiel de boire suffisamment d’eau, voire des boissons légèrement diluées en électrolytes. Cependant, il ne faut pas réhydrater trop rapidement, sous peine de provoquer des déséquilibres au niveau du cerveau.
Si l'hypernatrémie est liée à une pathologie sous-jacente (comme un problème rénal ou un diabète spécifique), un suivi médical est indispensable. Seul un professionnel de santé pourra adapter la prise en charge et vous proposer des solutions adaptées.
7. Causes et facteurs de risque du déficit en eau libre
Le déficit en eau libre résulte d’un déséquilibre entre les pertes hydriques et les apports en eau, conduisant à une hypernatrémie. Plusieurs conditions peuvent en être à l’origine. L’insuffisance rénale chronique, l’hyperglycémie, le diabète insipide ou encore la prise de diurétiques de l’anse sont des facteurs qui vont augmenter l’élimination d’eau sans compensation adéquate, favorisant ainsi la déshydratation intracellulaire.
Des causes plus courantes peuvent également être responsables d’un déficit en eau libre comme une fièvre prolongée, une hyperventilation, une transpiration excessive ou encore des vomissements répétés qui vont accélérer la perte hydrique, augmentant ainsi le risque d’hypernatrémie.
Certains individus sont particulièrement vulnérables à ce déséquilibre, notamment les personnes âgées et les nourrissons qui présentent un risque accru en raison de leurs besoins hydriques plus élevés et de leur régulation de la soif moins efficace.

Chez les personnes âgées, l’hypernatrémie peut se développer plus facilement. Ainsi, certains facteurs vont jouer en faveur de ce déséquilibre. La diminution de la sensation de soif, les traitements médicaux ou encore la réduction de la capacité rénale augmentent les pertes d’eau et en diminuent la consommation, ce qui provoque un déséquilibre hydrique. Par ailleurs, l’environnement a également un impact. En effet, un climat chaud va être à l’origine d’une transpiration qui peut être excessive et donc entraîner des pertes d’eau importantes. Cela peut avoir un impact sur les capacités cardiovasculaires et neurologiques et ne doit pas être négligé !
8. Déficit hydrique : Définition et différences avec le déficit en eau libre
Le déficit hydrique correspond à une perte globale d’eau corporelle, qui peut concerner à la fois l’eau et les électrolytes, notamment le sodium. Ce type de déséquilibre survient principalement en cas de vomissements, de diarrhées ou de pertes hydriques excessives, sans apport compensatoire suffisant. Contrairement au déficit en eau libre, le déficit hydrique n’affecte pas directement la natrémie, car l’eau et le sodium sont perdus de manière proportionnelle, maintenant ainsi une osmolarité plasmatique relativement stable.
La prise en charge de ces deux situations est différente. En cas de déficit hydrique, il est essentiel d’apporter des électrolytes en plus de l’eau pour rétablir un équilibre ionique stable. À l’inverse, pour corriger un déficit en eau libre, l’apport en eau pure ou en solutions hypotoniques est privilégié, en fonction des symptômes et du degré de déshydratation de chaque personne.
Dans cet article, nous avons vu comment calculer son déficit en eau libre ainsi que les conséquences et les symptômes liés à un déséquilibre hydrique. Il est important de garder une hydratation optimale afin d’éviter toute complication. Cependant, si l’un des symptômes que nous avons présentés se manifeste, nous vous recommandons de consulter un professionnel de santé pour avoir un bilan complet et obtenir un avis médical adéquat.
Bibliographie
L Berwert, B Vogt, M Burnier - Revue médicale suisse, 2010 - revmed.ch
Diagnosis and treatment of hypernatremia Saif A. Muhsin MBChB a, David B. Mount MD (Associate Chief)